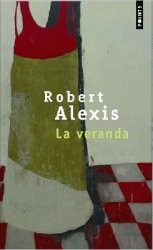L’écrivain Michel Le Bris, qui a créé il y a vingt ans le festival « Etonnants voyageurs » à Saint-Malo, a dû annuler l’édition de cette année en Haïti*, pour les raisons que l’on sait. En 2008, son roman La Beauté du monde a été retenu pour le Goncourt, attribué finalement à Atiq Rahimi pour Syngué Sabour. Pierre de Patience… La beauté du monde : comment résister au titre de ce gros roman ?

http://www.safarimuseum.com/
The Martin and Osa Johnson Safari Museum
Les images, au début, de la savane africaine où s’ébranle un troupeau d’éléphants filmés par Martin Johnson, caméra à l’épaule, rappellent le film de Sidney Pollack inspiré par La ferme africaine de Karen Blixen, Out of Africa, lorsqu’elle vole en compagnie de Denys Finch Hatton. Si la Danoise est brièvement évoquée par Le Bris, son amant, en revanche, joue les délicieux confidents auprès d’Osa Johnson, l’héroïne, l’aventurière, l’âme du récit de Michel Le Bris après avoir été celle des films de son mari. Un couple qui a réellement existé.
Modeste auteur d’un conte animalier et d’un récit pour adolescents, la jeune Winnie est engagée en 1938 pour écrire une biographie de la fameuse « légende moderne de l’Amérique ». C’est Osa qui a choisi cette jeune fille « jamais sortie de Wyaconda » parce qu’elle la jugeait capable de la comprendre vraiment, elle, une fille de Chanute (Kansas) devenue star. Et voilà Winnie au milieu du Tout-New-York : « Journalistes, photographes, chroniqueurs mondains, éditeurs, gens de cinéma, personnalités de la mode, membres du Muséum, gloires de l’exploration, ils étaient tous là, sous les lambris brillamment éclairés du Waldorf Astoria », où on expose aussi dans un décor « furieusement africain », la collection « Osafari » de vêtements de sport, avant l’entrée en scène d’Osa – « à elle seule, un album de clichés africains, un dépliant touristique, un catalogue de produits à l’africaine ».
Les premiers contacts déçoivent Winnie : un regard « absent, et froid », une femme qui boit trop, à qui manque son mari, ce Martin Johnson qui un jour a cassé son rêve de jolie maison pour famille nombreuse, obsédé par l’idée de « partir, faire le tour du monde ». D’abord sept longues années de galère, raconte Osa, un premier film sur les cannibales, pour continuer là où s’était arrêté Jack London, dont Martin avait été l’élève et l’employé.
Dans la “jungle urbaine” de New York, en 1920-1921, les Johnson attirent les regards avec leurs deux singes, Kalowatt et Bessie, qui ne les quittent pas. Martin est ambitieux. « Chevaucher la puissance du monde, ou se noyer ! » disait Jack London. Après le temps du livre venait celui du cinéma, pensait Martin. Quand un soir de 1920, il reçoit l’invitation de l’Explorer’s Club, à l’initiative de Carl Akeley, un naturaliste passionné par l’Afrique et le projet d’un grand Hall africain au Muséum, Martin exulte. « Comment expliquer, interroge Andrews, leur ami explorateur, que certains naissent ainsi, rongés de nostalgie, à croire qu’une part d’eux-mêmes leur manque, sans laquelle ils ne peuvent vivre, et qu’il leur faut traquer, en vain, jusqu’au bout du monde ? » Ce dernier rêve de retourner en Mongolie, dans le désert de Gobi dont il est tombé amoureux.
Martin, à seize ans, a décidé de « vivre de la photo ». Dix ans plus tard, il a épousé Osa pour vivre son rêve avec elle. Tandis qu’il rencontre tous ceux qui peuvent l’aider à financer son grand projet – filmer les animaux sauvages en Afrique, « le Paradis, juste avant la Chute » –, Osa découvre la vie new-yorkaise dont Le Bris se plaît à reconstituer les ambiances, les personnalités en vue. La première partie du roman ressuscite l’époque, explicite les motivations, la longue préparation des Johnson à leur voyage au Kenya en 1921 et 1922.
Et c’est ensuite, là-bas, que le roman se déploie. Aux descriptions très documentées du New York des explorateurs succède une aventure personnelle, la vie d’un couple en Afrique pour la première fois, le souffle coupé par « la beauté du monde ». A Nairobi, ils font la connaissance, entre autres, de Finch Hatton. Osa s’étonne des récits de chasse contés par tous les amateurs de vie sauvage. Pourquoi la violence se mêle-t-elle à l’approche et à l’admiration des animaux sauvages ? Plus douée que Martin pour la chasse, elle cèdera pourtant elle-même à l’ivresse du moment où le tireur ne fait plus qu’un avec sa cible.
Le Bris raconte tout : les conditions et les problèmes matériels de l’expédition, les errements, les attentes, les rencontres, les émerveillements, les tournages manqués, les images inattendues. A travers la découverte de l’Afrique, peuples, animaux, paysages, c’est la quête des premiers âges du monde, du Jardin d’Eden, par un homme et une femme que cette expérience nouvelle tantôt unit tantôt sépare. C’est splendide. Nous partageons leurs matins du monde enchanteurs, leurs nuits aux aguets, un bain solitaire dans le lac « Paradis » – « un lieu n’est pas un lieu si vous ne l’habitez pas ».
La troisième partie de La Beauté du monde, plus courte, montre que le retour n’est pas si aisé après un tel périple : « Voyage-t-on, en vérité, pour voyager, ou pour avoir voyagé – et que des mondes naissent, au retour, dans les mots prononcés, les images montrées ? » Il faudra que le film, le récit prennent forme, que New-York les reçoive. A Winnie de raconter la légende des « amants de l'aventure », à Le Bris d’exprimer comment « au mystère du voyage répondait d’étrange façon celui de la littérature ».
* * *
* « Mieux vaut allumer une chandelle dans l'obscurité,
que maudire l'obscurité. » (Confucius) :
l’appel à agir pour Haïti, à lire sur le blog de Doulidelle.